Après avoir passé deux semaines à Ispahan, je reprends la route en direction de Yazd et traverse le désert brûlant et venteux de Varzaneh.
À peine suis-je sorti d’Ispahan qu’un vieil homme m’arrête et m’interdit presque de passer par là : c’est le désert, bien trop difficile et c’est plus long de vingt-cinq kilomètres. Oui, mais par là, j’évite la route principale. J’insiste longuement et j’explique que je suis passé par bien pire au cours de ces cinq derniers mois, que j’ai parcouru presque neuf-mille kilomètres et que ce ne sont pas ces quelques kilomètres qui me font peur. Je réussis à continuer mon trajet et passe la petite ville de Varzaneh, je roule tout droit pendant cinquante kilomètres sur une route qui semble ne jamais finir, bordée à droite par des dunes et à gauche par des montagnes rocailleuses. Je suis quasiment seul. Je me laisse aller sans vraiment penser à ce que je fais, jusqu’à ce que je contourne une petite colline et que le vent se mette à souffler de face sur une route qui commence doucement à s’élever.

Autour de moi rien, pas un arbre, pas une maison, même pas en ruine, nulle part où trouver un peu d’ombre, nulle part où me reposer. Je me trouve en plein milieu d’un lac asséché encore signalé sur mon GPS et je dois lutter contre le vent pour avancer. Pour tenir le coup, j’écoute du Nirvana à plein régime. Plus loin, seul un caravansérail m’offre un endroit pour me reposer à l’abri et au frais.

Plus l’heure avance, plus le paysage m’émerveille. Je me retourne et regarde le soleil se coucher lentement et éclairer de sa lumière crépusculaire un horizon ciselé de petites montagnes. À chaque minute les couleurs changent et deviennent plus chaudes. Et il y a moi, au milieu de tout cela, tout petit, seul sur cette piste sur laquelle je continue à rouler face au vent avec peine, devant parfois pousser mon vélo quand le sable est trop abondant. Je souffre mais me délecte ! Au loin, j’aperçois quelques camions qui vont et viennent, jusqu’à ce qu’un pick-up s’arrête à ma hauteur et me propose de l’eau. Depuis Varzaneh qui se trouve à quatre-vingts kilomètres derrière moi, c’est la première occasion de la journée que j’ai de remplir mes réserves. Je n’hésite pas et je suis le pick-up jusqu’à une guérite à l’entrée d’un grand chantier. Là, on m’offre le thé et j’apprends que je me trouve sur le site de la plus grosse mine de fer d’Iran. En effet, les mineurs qui m’accueillent parlent tous anglais et forcément, ils rêvent d’un meilleur travail. L’un vient de Yazd, à deux-cents kilomètres d’ici, l’autre de Chiraz, à cinq-cents kilomètres : ils vivent sur place et rentrent chez eux pour une semaine au bout de vingt-trois jours. Comme souvent, nous parlons de l’Iran et de ses problèmes, mais aussi de ses villes et de sa beauté. Et quand je leur dis que je suis tombé amoureux d’Ispahan, le Chirazi bondit et vante les mérites de sa ville, bien plus jolie et établie depuis bien plus longtemps, avant même que le pays soit islamisé ! Chaque citadin a sa fierté et son cliché pour désigner ceux qui résident dans les autres villes : à Ispahan, les gens seraient avares, à Chiraz, feignants, à Qom, islamistes…

Cette nuit-là, je campe face à une barre rocheuse impressionnante, au pied de laquelle il n’y a qu’un immense désert avec quelques petites touffes d’herbes sèches. Au milieu grimpe la route que j’emprunte le lendemain pour rejoindre Yazd. Je pars tôt pour bénéficier des heures encore fraîches. La route monte lentement et m’amène sur un plateau désertique. Soudain, au milieu du sable, je vois des bâtiments se découper à l’horizon. Est-ce un mirage ? Non, les images se précisent, le trafic s’intensifie, c’est la ville qui se dresse là, à quelques kilomètres, en plein désert.
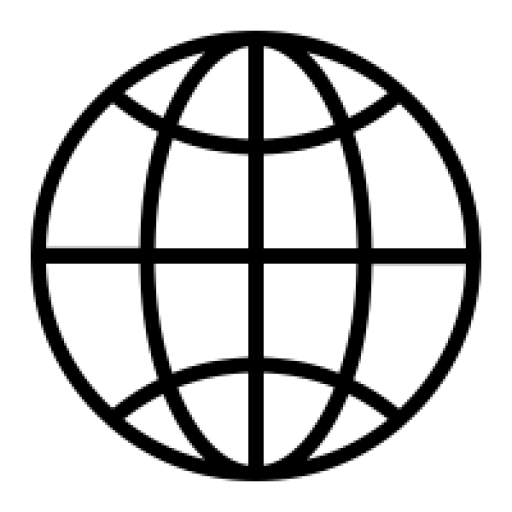

0 commentaires