Sommaire
La M41 en quelques mots
La Pamir Highway, c’est un peu le Graal de nombreux•ses voyageur•euse•s à vélo. Située en Asie Centrale, à cheval entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, elle fait le lien entre l’Orient et l’Occident à travers, pour sa section la plus élevée, le haut plateau du Pamir, dans le prolongement Nord de l’Himalaya. Oscillant entre 3500 et 4600 mètres d’altitude, la région offre des perspectives à couper le souffle, des paysages lunaires, hors du temps, où l’on côtoie des cimes qui culminent juste là, à 5 ou 6000 mètres. On est haut, on respire pas très bien et la nuit, il fait froid. De Douchanbé à Osh ou de Osh à Douchanbé, quelque soit votre trajet, la Pamir Highway est un moment suspendu.
Le tracé
Officiellement cette route s’appelle la M41. Elle part de Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, pour rejoindre Osh au Kirghizistan. Vous monterez progressivement sur une route défoncée, à flan de ravin, à travers des villages reculés où les enfants se rueront à votre rencontre pour vous saluer.
Le premier défi physique, c’est d’arriver à Kalai-Khum, située en bas col à 3 500 mètres. Là, vous suivrez le Panj qui sépare le pays de l’Afghanistan. Arrivé à Rushon, vous pourrez choisir de vous embarquer par la vallée de la Bartang si vous avez le goût de l’extrême ou pousser jusqu’à Khorog. Là encore, vous pourrez choisir entre le corridor du Wakhan en continuant à suivre le Panj ou rester sur la Pamir Highway et passer par Jelondy.
La Pamir Highway et l’itinéraire du corridor du Wakhan convergent à Alichur, le premier village du plateau. De là, vous rejoindrez assez facilement Murghab, la « ville » du coin avant d’affronter le col Baital, culminant à 4650 mètres. Derrière ce col, le lac de Karakul et son petit village, dernière étape avant la sortie du plateau et l’entrée au Kirghizistan où Sary-Tash sera le premier village que vous croiserez. Une fois à Sary-Tash, vous pourrez continuer jusqu’à Osh ou directement entrer en Chine pour rejoindre Kachgar.
La plupart des cyclistes prennent la route dans ce sens : parait-il que les vents y sont plus favorables. D’autres diront que la parcourir dans l’autre sens offre des vues encore plus dingues. Le mieux, c’est sans doute que chacun se fasse son avis en allant geeker sur la très riche section qui lui est dédiée sur le site Caravanistan ou en lisant les innombrables récits à son sujet sur le blog Entransat ou Rollingeast et un tas d’autres. Vous pouvez aussi lire mon récit, juste ici !
Ma Pamir Highway
Faut-il le rappeler, avant de faire ce voyage, je n’avais jamais vraiment parcouru les routes seule et je n’étais pas de ceux qui se disent adeptes des sports « outdoor ». Je suis parti en improvisant et en m’habituant progressivement à une vie plus simple où les efforts doivent être livrés au quotidien. C’est dans ces conditions et sans vraiment de préparation que je suis arrivé au Tadjikistan le 19 octobre 2019 et qu’au début du mois de novembre, j’attaquais les flancs d’une des routes les plus hautes du monde.
Départ de Douchanbé
Une centaine de kilomètres après Douchanbé, la route bifurque : à gauche direction le Kirghizistan en évitant la haute montagne, à droite, direction Khorog, dernière étape avant de monter à 4 000m sur le plateau du Pamir. Avec Pablo, compagnon de voyage pour quelque jours, on tourne à droite bien entendu, de la même manière qu’au départ de Douchanbé, on a choisi l’ancienne route. On sait que c’est par là que nous passerons par les plus beaux endroits. Sitôt avons-nous bifurqué que la route se dégrade : nids de poule, asphalte arraché par les camions, passages de cours d’eau, cailloux, terre, boue… C’est ce qui sera notre quotidien jusqu’au pieds du plateau du Pamir : pendant une petite dizaine de jours on sillonne donc cette ancienne route assez peu fréquentée mais si belle !

À mesure que nous avançons, la très haute montagne est à l’approche et des cimes enneigés se découpent derrière les arbres d’automne. On est presque seuls sur cette partie de la route et j’ai ce sentiment que jamais je n’ai encore ressenti jusque là dans ma vie : celui d’être loin, loin dans le monde, loin dans la civilisation, dans une province reculée, coupée du monde et ignorante de ses tourments. Au long de ce voyage, j’ai vu les mosquées, les bazars, les madrassas, les maisons historiques ; j’ai été charmé par le dédale de ruelles de villes inconnues, leurs parcs et leur patrimoine si riche et singulier ; j’ai visité les plus vieilles villes du monde, encore construites en torchis ; je me suis aventuré sous terre pour découvrir des cités souterraines, mais jamais je ne me suis senti aussi loin dans le monde qu’aujourd’hui ici, dans la Province Autonome du Haut Badakhshan (GBAO) qui n’est que montagnes et qui représente 45% du territoire tadjik pour 3% de sa population. Le GBAO est relié au reste du Tadjikistan par cette unique route, la M41, autrement appelée Pamir Highway pour son tronçon le plus élevé en altitude. Deuxième route la plus haute du monde, c’est presque un passage obligé pour tous les voyageurs et à la haute saison, en juillet et août, on y croise paraît-il beaucoup de cyclistes. D’ailleurs, la population locale semble relativement habituée à ce déferlement, à peine étonnée de nous voir passer Pablo et moi, si ce n’est que nous sommes bien en retard sur la haute saison et que nous allons avoir froid là-haut. Les quelques grosses bourgades que nous traversons proposent restos et homestays à foison mais, en cette fin de mois d’octobre, beaucoup d’entre eux sont fermés. On doit être les derniers cyclistes à passer avant l’année prochaine…

En queue de cortège, on profite d’autant plus de cette région reculée que nous sommes bien les seuls cyclistes encore debout. Tous ces villages que nous traversons, ils n’ont pas l’eau courante, l’électricité est rare, le réseau y est faible voire inexistant et les habitants partagent la rue avec chèvres, vaches et moutons. Dans les rares magasins, on ne trouve quasiment rien : un seul Snickers, du pain rassi, seuls des oignons et quelques carottes désechées en guise de légumes. Lorsque nous passons, c’est l’événement dans le village : les gamins déboulent de partout et nous tendent leurs mains sale avec une bouille souriante et baveuse. Les vieillards qui regardent le temps passer nous saluent, les femmes nous montrent du doigt à leur bébé et leur apprennent à dire “hello”, les hommes nous demandons d’où l’on vient en criant “Adguda ?” ce à quoi nous répondons en criant à notre tour “FRANCA” et “COLOMBIA” !
Première épreuve : rejoindre Kalai-Khum
La M41 nous emmène sur son terrain accidenté au fin fond du monde. Ça monte, ça descend et ça fatigue énormément, mais on ne cesse de s’émerveiller de cette région si belle où seule cette étroite route sur laquelle nous progressons difficilement témoigne des efforts de l’homme pour peupler cette région, où nous passons de longues heures sans jamais passer par un village, où toutes les 10 minutes, nous nous arrêtons pour contempler le spectacle et prendre quelques clichés. Devant nous, il y a, on le sait, une ascension difficile sur cette route rocailleuse où on dérape dès que l’on monte en danseuse ; un petit col à plus de 3200 mètres d’altitude, rien que ça. Plus les jours passent et plus on a hâte de s’y trouver au pied de cette montagne pour enfin s’y confronter et prendre une journée de repos de l’autre côté, à Kalai-Khum, sur la frontière avec l’Afghanistan. Le matin de l’ascension, mes deux pneus sont à plat ce qui retarde notre départ. Je peste comme c’est pas permis, j’en suis à presque violenter ma monture comme si c’était de sa faute.

L’ascension va durer 5 heures en comptant les quelques pauses. D’abord ces magnifiques arbres d’automne nous tiennent compagnie, puis la rivière se mu en simple ru et la végétation devient de plus en plus basse avant de se dérober complètement et de laisser place à de verts pâturages recouverts d’une neige éparse. On avance chacun à notre rythme. À mesure que je monte un épais brouillard nimbe mon parcours et ne m’offre que de très rares occasion d’y voir clair. De la journée, je ne croiserai presque personne sinon quelques ânes et quelques vaches. Derrière moi, cette vallée que nous quittons et au-dessus de moi, un ciel blanc qui présage de la neige là-haut, ma première neige ! Les derniers kilomètres seront difficiles : à cause du brouillard, je croirai avoir atteint le col à chaque tournant, quand il me restera en fait encore quelques virages. Et quand enfin je verrai peint sur un abris 3258,2 je pousserai un grand cri de joie et irai immédiatement m’y abriter.

Il y a du vent, il neige, il fait froid, mais je suis heureux ! En attendant Pablo, je me prépare pour la descente : quelques couches supplémentaires pour affronter le froid et la pluie, le Snicker d’usage et quelques tartines. La descente durera 4 heures, les mains crispées sur les manettes de frein, le regard à l’affût de tous les obstacles qui secoueraient trop le vélo et endommageraient les roues. Elle est magnifique cette descente. C’est l’entrée dans le GBAO, tellement plus sauvage. Jusqu’à Kalai-Khum, on ne passera par aucun village, sinon le checkpoint militaire d’entrée dans la province. Là-haut, on commence par suivre le cours de la jeune rivière qui ira plus loin se jeter dans le Panj. Elle sillonne dans un parterre d’herbe planté de rochers avant de déboucher sur un flanc de montagne à pic où l’on voit quelques centaines de mètres plus bas la route abîmée serpenter à perte de vue, sur des pentes vertigineuses. On arrivera de nuit à Kalai-Khum, soulagés mais euphoriques de cette journée titanesque qui m’aura fait passer le plus haut col du voyage.

Kalai-Khum est l’une de ces grosses bourgades où les homestays sont à foison : on trouve donc un endroit où dormir avec vue sur l’Afghanistan. On s’y reposera deux nuit avant de reprendre la route le long du Panj, frontière naturelle qui sépare les deux pays jusqu’à la Chine.
Au fin fond du monde (jusqu’à Rushon)
Pendant 4 jours, nous avançons dans un monde de plus en plus reculé où de plus en plus de longues barbes font leur apparition. La vallée encaissée ouvre parfois sur un bras plus large du fleuve ou se resserre si fortement que nous ne sommes qu’à quelques encablures de l’Afghanistan. Côté Afghan, les villages ne sont peuplés que de quelques maisons en terre reliés les unes entre les autres par une étroite piste caillouteuse à côté de laquelle notre M41 est un luxe suprême ! Nous pouvons distinctement entendre les bergers afghans diriger leur troupeau de chèvres à flanc de montagne, les enfants jouer et nous saluer à grands cris, les rares 4×4 klaxonner les groupes d’écoliers qui vont ou viennent de l’école. Un soir, on sera même surpris par un appel à la prière dans un village suspendu à flanc de montagne se trouvant juste en face de nos tentes.

Nous montons ainsi, tout doucement, le long du fleuve, sur cette route chaotique qui monte et descend et nous fait gravir des dénivelés supérieurs à 2 000 mètres chaque jour. Ici, il n’y a que cette route. Partout, il y a des pentes raides au-dessus desquelles jaillissent des pics et des monts enneigés, magnifiques, magiques, vertigineux. Bientôt nous les côtoierons. Et à notre hauteur, toujours ces arbres d’automne qui font une si belle composition avec ces montagnes blanches couronnées de nuages se découpant dans le ciel bleu. Plus les jours avancent, plus ils laissent tomber leurs feuilles qu’une brise dépose dans un parterre multicolore ou dans le petit ruisseau d’eau claire qui coule là, entre les rochers. On n’échappera pas à quelques journées pluvieuses et éprouvantes, mais la beauté de ce qui nous entoure l’emportera toujours sur la difficulté des conditions… Et au fond de nous, nous savons bien que d’autres moments difficiles nous attendent là-haut, à 4 000 mètres.

Arrivés au village de Rushon, on sent bien que ça y est, on y est dans les contreforts de ce vaste plateau du Pamir. On est à 2 000 mètres, l’air est plus frais et tout autour de nous il n’y a que pics enneigés. C’est là que nos chemins se séparent. Pablo ira donc sur une partie plus froide et plus reculée du plateau du Pamir, le long de la rivière Bartang. Pour ma part, je suivrai la M41 tout du long. Je laisse donc Pablo à Rushon et continue ma route à Khorog, capitale du GBAO, où la présence militaire est renforcée pour éviter toute dissidence suite à des échauffourées en 2012. Ici, on est d’abord pamiri. On ne parle d’ailleurs pas ce dérivé du farsi qu’est le tadjik mais un dialecte bien local et on revendique fièrement l’esprit montagnard. Khorog est le centre névralgique de la province et en pleine journée, l’agitation est intense autour du bazar.

On y vient des quatre coins du GBAO pour y trouver tout et n’importe quoi, mais surtout tout ce qu’on ne trouve pas partout ailleurs : quincaillerie en tout genre, vêtements, fruits et légumes variés et frais, pièces détachées de voiture, literie… J’y trouve de quoi traverser le froid des nuits là-haut sur le plateau : une énorme couverture qu’il faut encore que j’arrive à placer sur mon vélo, un rouleau de matériau isolant pour le sol de ma tente, d’épaisses chaussettes en laine, des gants fins, des chaussons fourrés… Mais rien pour mon vélo. Il faudra que je me rende à un autre bazar pour trouver un nouveau pneu arrière et remplacer celui qui m’a fait de nombreuses fois défaut sur la route depuis Douchanbé.
C’est parti pour la bagarre (départ de Khorog)
À Khorog, l’air est frais et on se sent isolé de tout, entouré de cette nature imposante. Quand on lève la tête, on ne voit que des montagnes aux cimes blanchies. Je m’y repose le temps qu’il faudra pour que je me sente d’attaque pour monter à 4 000 mètres. Ici converge depuis les montagnes la maigre population de la région pour y trouver tout ce dont elle a besoin. La veille de mon départ, je rencontre un autre cycliste qui lui a choisi de passer par le corridor du Wakhan, le prolongement de cette route longeant la frontière afghane que j’avais suivie jusque là. Après un dernier au revoir à Pablo, j’étais enfin en route pour une dizaine de jours, mon vélo augmenté de quelques kilos glanés en nourriture et fourrures dans le bazaar, à rouler entre 3600 et 4650 mètres au-dessus du niveau de la mer.

J’ai mis trois jours à monter sur le plateau du Pamir. J’avais auparavant beaucoup lu sur le mal des montagnes et me préoccupais du moindre signe suspect. Mais rien, fort heureusement. Pendant les deux premiers jours, les arbres d’automne qui m’avaient tant charmé depuis Douchanbé continuaient à m’accompagner. Je passais par de petits villages encore irrigués par des rivières qui descendaient de la montagne et dans lesquelles je pouvais boire directement. Je voyais là mes dernières petites exploitations agricoles avant le désert du Pamir. Plus j’avançais, plus les cimes enneigés que je voyais depuis Khorog se faisaient imposantes. Après deux jours, j’arrivais l’air de rien à Jelondy, éloigné d’une centaine de kilomètres d’Alichur, le premier village du plateau. J’étais entouré de hautes montagnes, l’air se rafraichissait et les arbres se faisaient de plus en plus rares. Je commençais à sentir l’air frais passer à travers mes baskets et se saisir de mes pieds emmaillotés dans des sacs poubelles. Là, on m’avertit du froid qu’il faisait là-haut et un passant m’offrit son épaisse paire de chaussettes que j’ai aussitôt enfilée.
Gros doutes en terres Tadjikes (après Jelondy)
Passé Jelondy, les arbres disparurent définitivement et je n’en revis que quelques semaines plus tard, quand j’eus atteint la Chine. Je continuais mon ascension les pieds quelque peu réchauffés, tout en voyant au loin devant moi le ciel devenir de plus en plus menaçant. Quand l’oxygène manquant et le blizzard me soufflant au visage se mirent à trop éprouver mes limites physiques, je mis pied à terre et poussai mon vélo, le froid se saisissant lentement de moi. Pour la première fois de ma vie, je faisais l’expérience de ce qu’était le manque d’oxygène en altitude : on s’essouffle pour un rien et le moindre effort paraît insurmontable. Peu habitué à ces conditions, je sentais l’adversité que représentaient les jours que j’allais passer et déjà, je commençais à me décourager, espérant, au fond de moi, trouver un camion qui veuille bien me mener aussi loin que possible de là, dans un endroit où je pourrais me réfugier à l’intérieur. C’est alors que je vis s’approcher au loin un homme cagoulé, les mains dans les poches, se baladant nonchalamment sur les bords de la route. Il vint à ma rencontre et me demanda où j’allais. Je lui expliquais que je me dirigeais vers Murghab, la “ville” au cœur du plateau, et quand il comprit que j’étais seul, il hocha la tête en signe de désapprobation. Il se décida finalement à m’emmener chez lui, une petite bicoque au pied de l’ascension du col ouvrant sur le plateau du Pamir. De chez lui, je pourrais attendre qu’un camion passe et m’emmène plus loin, hors du mauvais temps. J’étais soulagé d’entrer dans un endroit chauffé et encore plus soulagé quand je compris qu’aucun camion n’allait passer du reste de la journée, me permettant de me reposer dans ce petit intérieur qui m’a paraissait un grand luxe !
Mon séjour ici se réduisit à patienter dans une petite pièce de 15m2 avec la mère, le père et le neveu du promeneur. À mon entrée, la mère était en train de préparer une trentaine de pains sur la banquette servant à la fois de lit et de salle à manger. Le père patientait dans un coin, réchauffé par le poêle et hocha lui aussi la tête quand il comprit que j’étais seul. Quant au neveu, il tournait en rond et s’amusait à embêter le chat qui était tranquillement blotti contre le poêle. Il me sembla que tous passaient leur vie à patienter, attendre que le temps s’écoule quand ils n’avaient pas l’eau ou du combustible à aller chercher dehors. Seule la mère était tout le temps active, à passer le balais, entretenir le feu, préparer le repas ou faire en sorte que le petit intérieur reste en ordre. Ils avaient tous des gueules comme on dit. La mère, le nez busqué et l’œil blanc, un fichu jeté sur la tête était tout le temps pliée en deux, comme si elle avait toujours à s’affairer quelque part. Elle ne m’adressa jamais la parole et ne fit que me tendre à manger. Le mari, l’œil vitreux, portant une petite moustache et affublé d’une casquette aidait de temps en temps sa femme quand elle le lui demandait, tout en prenant son médicament pour les yeux à intervalles réguliers. Le fils, qui m’avait récupéré sur la route, avait le regard dur, les traits secs et se languissait sur la banquette quand il ne sortait pas dehors pendant de longues minutes, pour se promener le long de la route à regarder les voitures passer. Le petit-fils enfin, blond, de grands yeux et la tête quelque peu déformée, probablement dans les 10 ans, ne tenait pas en place dans cette petite pièce où l’espace manquait. Comme son oncle, il portait un simple pantalon de jogging, même quand il se rendait dehors. Je ne parvins pas à comprendre ce qu’il en était de ses parents. Pendant tout l’après-midi, j’étais là, dans mon coin, à les observer.
Le soir, la mère nous servit une soupe et s’en alla manger dans une autre pièce avec son petit-fils. Je passai la nuit ici et me fit réveiller le lendemain matin alors qu’elle était affairée à rallumer le poêle pour préparer le petit-déjeuner : du thé au lait salé, dans lequel on fait fondre du beurre de yak et tremper des morceaux de pain. C’est simple, ça tient au corps, mais ce n’est pas d’une grande finesse, comme d’ailleurs le reste de la nourriture de cette région qui consiste globalement en quelque chose d’aqueux dans lequel on trempe quelque chose de solide pour le rendre plus mou pour le pain ou plus tendre pour la chèvre. Il y a aussi le plov, plat d’Asie centrale par excellence et qui est souvent l’unique proposition dans les rares petits restos où s’aventurer : du riz cuit avec des carottes et des dés de bœuf secs, le tout baignant dans l’huile pendant des heures et vraiment écœurant à la longue. Avec ces plats, on sert quantité de pain : quand on a de la chance il date de la veille, sinon, on en est réduit à des morceaux datant de plusieurs jours et dans lesquels quelqu’un a déjà sans doute mordu. Ici, le pain ne se jette pas…
-30°C ? Pas de problème !
Au matin donc, je passai le nez dehors pour m’enquérir des conditions d’ascension et résolu de passer en vélo. Le ciel était dégagé et le soleil me réchauffait. Je partis donc pour m’élancer à la conquête du premier 4000 mètres de ma vie. Mais rapidement, le vent soufflant trop fort, l’oxygène manquant et la neige s’invitant à la fête, je dû encore une fois mettre le pied à terre et pousser mon vélo. Autour de moi, la neige avait tout recouvert et je ne voyais que des plaines blanches à perte de vue. En chemin, je croise quelques yaks conduits par deux bergers. C’est la première fois que j’en vois et la bête est impressionnante ! Après quelques heures, j’arrive enfin sur le plateau, baigné d’un soleil criard où je je ne vois à l’horizon rien qu’une plaine blanche et glaciale sur laquelle sillonne ma route, elle aussi immaculée.

Au fond de moi-même, je rêve déjà d’être sorti de là et m’imagine tous les scénarios possibles. Après quelques temps, je vois arriver ma providence : un camion. Il m’emmène jusqu’à Alichur sur cette route, glissante et chaotique, où je n’aurais pas résisté longtemps. Arrivé là, je me réfugie dans le premier homestays venu et m’y repose avant de repartir le lendemain, pas certain de continuer jusqu’au bout.

C’est un paysage hors du temps que je découvre dans ce village. Tout est blanc, glacial, hostile. Le matin, le thermomètre affiche -30 degrés. La lumière est crue, rasante. De la fumée s’échappe des cheminées, du linge sèche au grand air, des vaches broutent ce qu’elles peuvent près des maisons de leurs maîtres, les gens s’affairent à puiser de l’eau et on sent partout cette odeur particulière, si typique du plateau, celle qu’émet la bouse de vache séchée utilisée comme combustible dans les poêles des maisons quand le charbon manque. Je me promène dans ce village, observant ce monde si différent et si lointain, jadis aux confins de l’URSS et maintenant aux confins d’un tout petit pays, isolé du reste du monde. En été, beaucoup de cyclistes doivent s’arrêter ici, mais en cette saison, je suis le seul à m’y trouver et les villageois ne manquent pas de s’étonner quand ils me voient déambuler entre les maisons.
Depuis Alichur, j’ai une centaine de kilomètres pour rejoindre Murghab, d’où, si les conditions ne s’améliorent pas, je prendrai un camion pour sortir du plateau et entrer directement en Chine.
Le jour de mon départ, je roule pendant quelques kilomètres sur le verglas qui a remplacé l’asphalte de la route. Je finis inévitablement par glisser et tomber, mais sans heurts. Après une dizaine de kilomètres, la neige disparaît comme par enchantement et la route chaotique se mue en bel asphalte. Les conditions s’améliorent, je reprends des forces et roulerai 100 kilomètres en une journée pour la première fois depuis bien longtemps. Autour de moi, des pics qui culminent à 5, 6000 mètres. C’est grandiose et brutal. Pas d’arbres dans cette nature désertique qui s’étend à perte de vue et dans laquelle ma route s’aventure sans que je ne comprenne bien comment elle va passer ce mur montagneux qui se dresse là, devant moi. Mais toujours, elle trouve un chemin où se frayer sans m’imposer trop d’effort.

Parfois, je vois au loin des maisons isolées qui m’ont été signalées par l’odeur de la bouse brûlée. D’autres fois, je croise la route d’un troupeau de yaks qui broute paisiblement dans la neige, j’aperçois même un renard fuir à mon approche et des oiseaux de proie, sans doute des aigles, voler haut dans le ciel. Et à mes pieds, une myriade de petits oiseaux gris s’envole par nuées à mon passage, m’offrant comme une haie d’honneur. Puis ô miracle, la route se met à descendre ! Sans m’en rendre compte, j’ai passé un col à 4100 mètres et je peux filer sans trop d’effort jusqu’à Murghab. Quant à la neige du bord de la route, elle à totalement disparu et je découvre un paysage qui m’évoque le désert iranien. Des montagnes toutes pelées, des cailloux et une végétation sèche et rase, sauf qu’ici, quand je lève les yeux, je vois le toit du monde ! Sauf qu’ici, il fait froid et l’eau gèle au lieu de bouillir dans mes gourdes.

Murghab : on continue ?
Arrivé en vue de Murghab, j’étais comme soulagé. Au fond de moi, l’intention d’y prendre un camion pour la Chine était encore quelque peu vivace. Je voyais cette petite ville au loin, passage obligé de tous les camions reliant la Chine au reste du Tadjikistan, poumon économique de 4000 habitants pour cette partie extrême du GBAO, nichée au fond d’une plaine dans laquelle paissaient quelques yaks. La lumière en cette fin de journée dorait la plaine et les montagnes encadrant ce spectacle. Un vent me poussait jusqu’à la ville et j’arrivai alors que la nuit tombait. Installé confortablement, j’y suis resté deux jours et résolu de continuer sur la Pamir Highway malgré, il faut le dire, ce qu’espéraient certains de mes proches : si je suis ici, il faut que je profite de l’occasion pour rouler sur cette route mythique… À condition toutefois que je remplace mes baskets par de vraies chaussures de montagne.

À Murghab, la lumière est claire et froide et vient lécher les façades blanchies à la chaux des maisonnettes. La moindre ombre laisse le froid s’installer et, comme à Alichur, toutes les cheminées tournent à plein régime et laissent échapper une fumée marron dans le ciel. Je loge en surplomb du bazar, un enchevêtrement de containers qui ont été posés là, à la va-vite, dans lesquels les commerçants se sont installés. J’y trouve de bonnes chaussures et même de quoi remplir mes sacoches de Snickers !
Ici, il y a cette rencontre du monde russe et du monde chinois, deux empires si proches de ce petit pays et de cette petite ville au milieu de nulle part. Les camions qui vont et viennent sont tous chinois et m’habituent progressivement à ce nouvel alphabet, tandis que dans la ville, il m’arrive de croiser des véhicules immatriculés en Russie et puis bien sûr, j’y trouve une statue de Lénine.
Les physiques changent aussi. À Alichur, j’avais commencé à croiser quelques visages aux traits asiatiques parmi une majorité de Tadjiks. Mais à Murghab, ces Kirghiz sont en majorité et on les reconnaît non seulement à leur yeux, mais aussi au couvre chef des hommes, qui n’est plus cette toque carrée que portent Tadjiks et Ouzbeks, mais le Kalpak, un haut chapeau rigide aux bords arrondis et fendu au niveau du front.
Dormir par -30 à 4200 mètres d’altitude en novembre
De Murghab, ma prochaine épreuve s’annonçait de taille : le col Ak Baital, culminant à 4650 mètres au-dessus du niveau de la mer, en faisant le plus haut point de la route et sans conteste le plus haut point où je n’aie jamais été de ma vie. Je quittais la ville comptant camper à quelques kilomètres du pied du col. Sur ma route, toujours ce désert sans eau ni végétation, toujours ces étendues brutales et de longues traversées solitaires où je pouvais admirer chacune de ces très hautes montagnes qui culminaient au loin. Et tout à coup je vis des barbelés. La frontière chinoise ! La Chine si lointaine et où il est si difficile d’entrer se trouvait là, à quelques enjambées, je pouvais même y passer là où la clôture avait ployé. J’éprouvai une certaine émotion à le voir si proche ce pays. Mais j’avais encore du chemin avant de le rejoindre ! Je grimpais ainsi doucement, impressionné non seulement d’être aussi haut, mais aussi d’être arrivé jusque là !

Quelques heures avant que le couché du soleil et que l’air glacial ne s’installe, j’ai planté ma tente pour une nuit tourmentée, régulièrement réveillé par le froid, après avoir essayé de cuisiner tant bien que mal mes pommes de terre congelées avec mon réchaud cassé. Au matin, une fine couche de glace s’était déposée sur moi. Malgré mon duvet, ma couverture et mon isolant pour sols acheté à Khorog, je n’étais définitivement pas assez équipé contre le froid et, après cette nuit, il était hors de question que je dorme une nouvelle fois dehors. Heureusement, la Pamir Highway reste relativement peuplée et il est toujours possible de trouver un intérieur où s’arrêter. D’ailleurs, quelques kilomètres plus loin, je trouvai une maison se tenant au pied de l’ascension du col, où j’en profitai pour prendre le thé et quelques forces avant de repartir, n’ayant au réveil plus d’eau et des provisions congelées.

Les premiers coups de pédales me semblèrent faciles et je parti optimiste. Mais rapidement, la route s’est élevée raide et je dû, encore une fois, pousser mon vélo jusqu’en haut. Plus je montais, plus la route se détériorait, mais, fort heureusement et malgré l’altitude, pas de glace ni de neige ne gênaient l’ascension. Là-haut, j’étais entouré de montagnes dont je n’osais imaginer l’altitude et tout était blanc sous un ciel d’un bleu pénétrant. Je n’avais plus qu’à descendre jusqu’au lac de Karakul, où j’avais décidé de terminer ma journée. Mais la descente, malgré le spectacle grandiose de la montagne, n’a fait que m’enrager. J’évoluais sur une route où s’étaient formés sous l’effet du vent des ondulations à la manière d’une feuille de tôle. Sur la dernière portion, je pris un itinéraire détourné à travers une steppe sableuse où je dû franchir une large rivière glacée sur laquelle j’appréhendais le moindre mouvement brusque qui allait faire craquer la glace.
Ô lac !

À chaque petit talus franchi, à chaque tournant, j’espérais le voir soudain apparaître ce lac, mais ce n’est qu’à la tombée de la nuit, quand je rejoignis enfin une route asphaltée, qu’il s’offrit à moi, entouré de dômes blancs dorés par la lumière du soleil couchant, dépassant de volutes nuageuses. La nuit tombait progressivement et le ciel se teintait petit à petit de mille couleurs. Je m’attendais à tout instant à voir les lumière du village, mais rien, jusqu’à ce mon GPS me dise que j’étais arrivé.
Dans le Pamir on vit coupé de tout réseau, qu’il soit électrique ou hydraulique. Alors l’eau comme l’électricité sont des biens que l’on économise. On va la puiser à la rivière ou dans un puits, on la récolte au moyen d’un panneau solaire qui alimente une batterie de voiture depuis laquelle on tire les différents câbles électriques utiles à la maison et forcément, on ne décore pas sa maison de mille feux.
Je m’arrête chez une famille qui veut bien m’accueillir pour deux nuits, après avoir trouvé plusieurs fois porte close. Le mari, la femme et leurs deux enfants en bas âge cohabitent dans l’unique pièce chauffée de la maison. Les enfants jouent et courent dans tous les sens autour de leur grand-mère venue s’occuper d’eux tandis que la mère s’affaire à entretenir la maison tout en donnant le sein dès que la petite en manifeste l’envie. Le mari sort de temps en temps faire une commission. Il a une rage de dent et ne pourra se faire soigner qu’à Osh ou à Khorog, à plusieurs centaines de kilomètres de là. J’ai définitivement fait un bon dans le temps. Le soir, la pièce se transforme en chambre et on étale par terre des futons que l’on recouvre d’épaisses couvertures. Toute la famille dort ensemble et moi, je suis juste à côté d’eux.
Pendant deux jours, je vis avec eux et me surprend à m’habituer à tout ce qui, quelques semaines plus tôt, m’aurait paru si peu usuel. La promiscuité d’abord, puis ces fins futons que l’on jette par terre en guise de lit, ou encore cette odeur permanente de bouse séchée, le thé que l’on boit pendant le repas en lieu et place de l’eau fraîche, le pain que l’on conserve pendant des jours et des jours sans jamais le jeter, cette économie que l’on apprend à faire de l’eau, aux frontières de l’hygiène… Comme je m’étais habitué aux petites choses qui forgent ce qu’est l’Iran, je me suis progressivement habitué aux petites choses qui constituent la vie tadjike, après presque un mois passé ici.

Le village de Karakul est encore plus isolé qu’Alichur. Là, les camions chinois ne passent plus, seuls quelques 4×4 y font l’étape sur la route de Murghab à Osh. Il n’y a rien à des kilomètres. Ce lac, vide de poissons et la M41 qui voit de temps en temps passer des voyageurs sont les seuls attractions. En m’y promenant, je tombe par hasard sur Pablo, tout juste arrivé de la vallée du Bartang. Sans internet depuis plusieurs jours, on en croit pas nos yeux. On parle pendant des heures de notre aventure récente sans vraiment pouvoir s’arrêter. Il a cassé son vélo en chemin et a dû le pousser pendant 150 kilomètres. Pablo finira donc sa route en taxi. Quant à moi, je continue avec comme objectif d’atteindre en une journée Sary-Tash, le premier village Kirghiz, situé à 100 kilomètres de là.

Je longe le lac, le vent dans le dos, pendant quelques kilomètres jusqu’à ce que je croise un sud coréen partant à l’aventure de la vallée du Bartang. Je lui souhaite bon courage et continue ma route. De Sary-Tash, deux cols me séparent. Le premier est relativement doux. Même si je dois pousser mon vélo pour le franchir, il n’y a pas de neige. De là-haut, je peux jeter un dernier regard au lac qui s’étend à mes pieds puis m’élancer dans une plaine rocailleuse et poussiéreuse où le vent me souffle à la figure. À ma droite, il y a toujours les barbelés chinois, parfois à terre, parfois ouverts. Le paysage est encore plus désolé, brutal et hostile, mais grandiose et lunaire.

Arrivé en bas du deuxième col, je comprends vite que je vais devoir à nouveau pousser mon vélo. La route s’élève brutalement et neige et verglas font leur apparition. Je pousse ainsi jusqu’au sommet pendant deux heures, avec peine, mes doigts de plus en plus douloureux, tâchant en permanence de ne pas glisser, emporté par mon vélo.

Là-haut, j’atteins enfin le poste frontière tadjike, un endroit désolé, aux vitres brisées, où quelques chiens errent et où je peine à trouver quelqu’un pour tamponner mon passeport. On est à 4200 mètres d’altitude, dans l’un des endroits les plus reculés du monde et je plains ce militaire qui est établit ici et à qui j’offre un Snickers après qu’il m’ait permis de me réchauffer les mains autour de son poêle. En partant, il m’indique que le poste frontière kirghiz se trouve à 10 kilomètres en descente, je réenfourche mon vélo, optimiste. Mais je déchante rapidement quand je m’aperçois que la neige est sur ce versant encore plus abondante et que rouler en descente dans ces conditions est encore plus difficile que de monter. J’avance donc prudemment, mon pied droit servant d’appui et de contrepoids. Quand vint enfin la descente du col, 5 lacets de verglas, il était 16 heures et je compris que jamais je n’arriverais à rejoindre Sary-Tash, duquel j’étais encore séparé de 40 kilomètres. Il me faudra trouver un endroit où dormir dans le no man’s land. En bas du col, je tombe sur cette maison où je passe la nuit, ma dernière nuit dans le Pamir, chez une famille où les enfants font tout leur possible pour m’inclure dans leurs jeux.
Dernière épreuve : sortir du plateau

La sortie du plateau à quelque chose d’exceptionnel. On descend lentement dans ce paysage immaculé, pour savourer ces derniers instants. Pendant les premiers kilomètres, on évolue entre les montagnes, toujours sur neige et verglas. Puis les montagnes s’écartent, la neige disparaît et suit le cours asséché d’une imposante rivière. Je repense aux hauteurs où je me trouvais pendant ces derniers jours et, en vue de Sary-Tash, c’est avec émotion que je me retourne et les vois, maintenant si loin. Là, j’évolue dans une prairie où paissent chevaux et vaches avec le Pamir en arrière-plan sur une route impeccable qui me mènera doucement jusqu’à l’étape finale de ma traversée du Pamir d’où, après quatre jours sans nouvelles, je pourrai rassurer ma famille.

Au milieu du village, un rivière coule et l’on vient s’y approvisionner en eau. Les vaches circulent librement dans les ruelles de terre et le linge sèche dans l’air glacial. Le lendemain de mon arrivée, la neige se met à tomber drue et d’un seul coup, je passe de l’automne à l’hiver, heureux d’être arrivé à temps. J’apprendrai plus tard que la descente fut dès lors verglacée du haut du col jusqu’à après Sary-Tash.

Dans ma maison d’hôte, je tombe sur un couple de suédois que j’avais rencontré à l’ambassade Chine à Téhéran. On ne peut plus s’arrêter de parler, pour partager tout ce que l’on à traversé depuis. Ils partent la veille de mon départ et je les reverrai à Kachgar, côté chinois.
Je passe pas mal de temps dans le restaurant, à écrire et me remémorer des jours passés. J’y croise beaucoup de routiers kirghiz et chinois qui y font étape. Je sympathise presque avec l’un d’eux à qui je sers d’interprète : chinois, il ne sais pas comment demander une soupe en kirghiz. Je demande donc pour lui une “chorba”, le même mot qu’en arabe et il me sourit, satisfait. Un autre routier, kirghiz cette fois, s’approche et veut que je lui montre des photos de Khorog et de Kalai Khum, tout cela dans un mélange de russe (que je ne parle pas mais qui m’est de plus en plus familier) et d’anglais. Dans ce petit endroit, aux portes de la Russie et de la Chine, je m’amuse de ce joyeux mélange et de cette attraction que je représente tout à coup.
Je quitte Sary-Tash le lendemain de la première neige, alors que tout le village avait été recouvert d’un blanc manteau qui donnait une tout autre teneur au paysage. Roulant plein est, je laisse à ma droite le plateau immaculé, le soleil perçant dans un ciel troublé par les récentes précipitations et m’attaque au dernier col de mon périple montagnard, que je finis par passer sans vraiment m’en rendre compte mais tout de même sur une route verglacée. Je croise beaucoup de camions qui relient probablement Kachgar en Chine à Osh au Kirghizistan et quand ils me viennent de face, ils lèvent derrière eux une neige fine qui vient me fouetter le visage. À chaque passage, je retiens mon souffle et redouble de concentration, tandis que ceux qui me dépassent me frôlent. Et le plateau s’étend toujours là, juste à droite, jusqu’à ce que je m’enfonce au creux d’une vallée pour le premier point de contrôle kirghiz, depuis lequel je devrai remonter pour passer la frontière et entrer dans le no man’s land entre la Chine et le Kirghizistan.

Le paysage change doucement, mais toujours aucun arbre à l’horizon. Seul un grand canyon, lit d’un fleuve presque asséché en cette saison. J’éprouve une vraie excitation à l’idée que je vais bientôt rejoindre la Chine et que je l’aurais rejointe à vélo ! Déjà, quand j’avais vu pour la première fois les barbelés chinois au Tadjikistan, je m’étais arrêté, subjugué d’être arrivé là, dans ce pays si lointain (presque) entièrement à vélo !
J’arrive dans la zone frontalière chinoise avant la fin de la journée, à temps pour passer tous les checkpoints. Les documents secrets sur le Xinjiang ont été publiés par le New York Times la veille de mon arrivée à la frontière et j’ai peur que l’entrée dans la région soit de ce fait rendue plus difficile pour les étrangers car j’entre justement dans le Xinjiang et dans un pays où les libertés sont beaucoup plus contrôlées que ce que j’ai pu vivre jusqu’à maintenant.
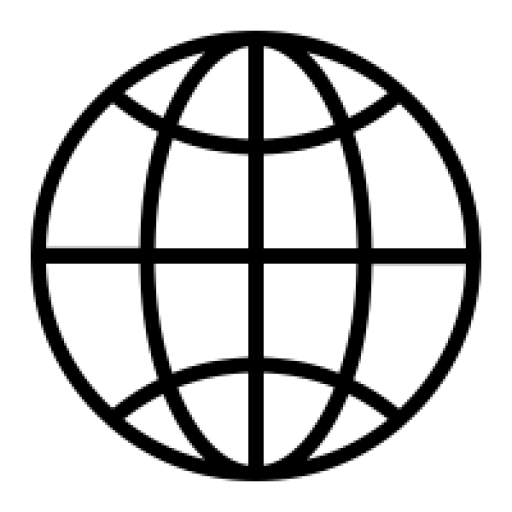

0 commentaires